Perception et appréciation des couleurs, une question objective ?
Toute personne voyante, hors anomalie visuelle, est en mesure de percevoir les couleurs : nous sommes capables de désigner le rouge, de le distinguer du bleu et d’en différencier le vert. Si leur perception est instinctive pour nous, pouvons-nous les appréhender complètement ?
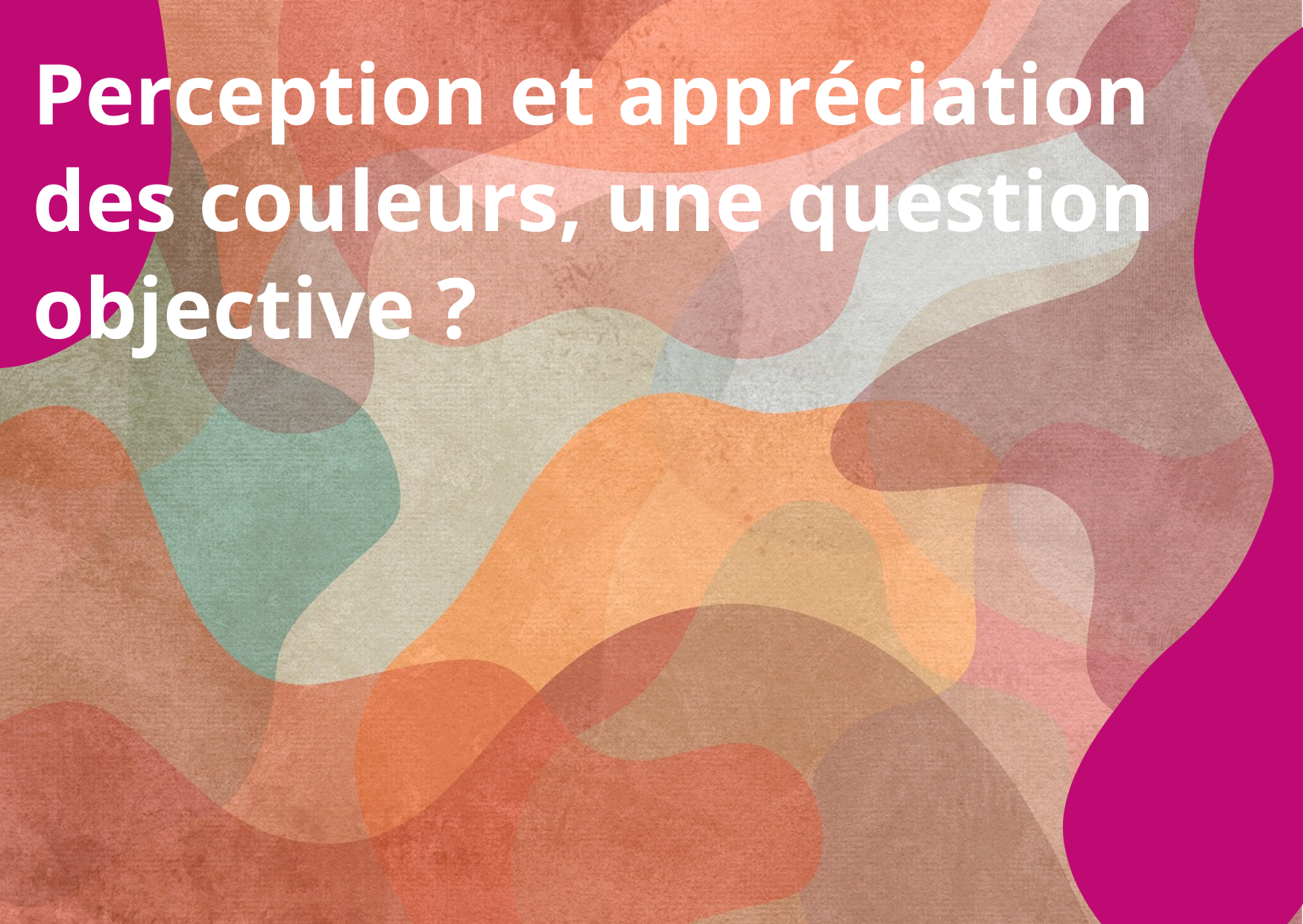
La perception des couleurs est le résultat d’un échange entre notre œil et notre cerveau : tout objet renvoie de la lumière autour de lui ; notre rétine capte cette lumière, appelée longueur d’onde, la transmet à notre cerveau sous forme d’impulsions électriques. Notre cerveau va alors associer une couleur à chaque signal donné.
C’est une des premières choses qu’apprend le nourrisson : à la naissance, la vision du bébé est floue et sa perception des couleurs est limitée aux contrastes (noir, blanc et gris). Vers l’âge de trois mois, il est en mesure de distinguer les couleurs primaires, notamment le rouge et le vert. Ça n’est qu’à cinq mois que sa perception est similaire à celle de l'adulte.
Cependant, si les couleurs ont été appréhendées d’un point de vue scientifique, leur appréciation subjective reste, du moins en partie, un mystère. C’est ce que tente d’expliquer le philosophe Franck Jackson dans un article de 1986 : « What Mary didn’t know ».
Mary est une scientifique experte en couleur et sait tout ce qu’il y a à savoir dans son domaine de prédilection. Mais elle a vécu toute sa vie dans un laboratoire noir et blanc et n’a donc aucune expérience sensible des couleurs. Que se passera-t-il, si quelqu’un l’emmène hors de son laboratoire ? Jackson affirme que Mary parviendra à une nouvelle compréhension des couleurs, alors qu’elle avait pourtant toutes les connaissances techniques et scientifiques sur le sujet. Elle ne parviendra pas à expliquer précisément cette nouvelle perception, puisque cette dernière se fonde sur une expérience sensible et subjective.
Cet article permet d’introduire le concept philosophique des qualias, apparu pour la première fois dans les travaux du philosophe américain Pierce. Il s'agit de l’effet produit en nous par une expérience subjective. L’acidité du citron par exemple : est-elle identique pour tout le monde ? Nous ne pouvons pas répondre à cette question.
Le même problème se pose dans l’appréciation des couleurs : voyons-nous tous le même rouge ? Nous serions tentés de répondre par oui, puisque si certaines anomalies visuelles, telles que le daltonisme et la tétrachromatie, ont pu être identifiées comme telles, c’est bien parce qu’il existe une base objectivable dans la perception des couleurs. Ces personnes ne les voient pas comme la majorité d’entre nous. Ces cas particuliers sont le résultat de défauts de la vision parfaitement mesurables (un problème de captation de la lumière par la rétine par exemple). Cela ne dit rien de l’expérience intime et du « ressenti » particulier que peuvent éprouver deux individus à partir d’une même couleur. Une personne peut qualifier le jaune de couleur chaude. Mais comment savoir ce qu’elle exprime par-là ? Qu’en dirait son voisin ?
On constate ainsi que la perception et l’appréciation des couleurs est une question éminemment subjective, alors même qu’il s’agit d’un phénomène scientifique tout à fait connu. Alors, existe-t-il des facteurs qui peuvent expliquer une différence au niveau de notre perception des couleurs ?
La langue joue ici un rôle majeur : toutes n’utilisent pas les mêmes mots pour désigner les teintes et leurs nuances. Selon les chercheurs Berlin et Kay, le développement des noms de couleurs dans les langues suit un schéma universel : toutes les langues se structurent autour du noir et du blanc. Si une troisième couleur apparaît, c’est toujours le rouge ; ensuite, viennent généralement le vert et le jaune ; puis le bleu ; et enfin d’autres couleurs comme le orange et le violet. C’est pour cela que certaines langues n’ont que deux mots pour désigner les couleurs, ou qu’en vietnamien par exemple, les mots “bleu” et “vert” sont identiques (« xanh »). En russe, il y a deux mots pour désigner le bleu : “синий” (« siniy ») pour le plus foncé et голубой (« goluboy ») pour le clair.
Si l’appareil visuel et le processus physico chimique est le même pour tous les êtres humains, il y a cependant des différences d’appréciation, d’interprétation et de verbalisation qui s’inscrivent dans des cultures données. Entre le bleu clair et le bleu foncé, nous voyons seulement une différence de nuance. Pour les Russes, il s’agit de deux couleurs distinctes, et cela permet sans doute plus de subtilité dans la perception des teintes et de leurs nuances.
Les facteurs culturels, langagiers et même économiques ont une incidence majeure sur notre façon de dire et de penser les couleurs. Cela nous permet d’expliquer les différences au niveau de la sémiologie des couleurs : le rose est aujourd’hui associé à l’amour, mais aussi au vulgaire ou à la mièvrerie. Cette diversité sémiologique est due à son histoire, que Michel Pastoureau, historien des couleurs et sémiologue, détaille dans son dernier ouvrage Rose. Histoire d’une couleur. Ce sont les conditions économiques de l’époque qui déterminent l’usage du rose. Il est devenu très populaire grâce à l’exportation du bois de Brésil ramassé aux Indes, qui possède de grandes vertus tinctoriales. Il sera associé à tout le courant romantique au milieu du XVIII°, avant de devenir mièvre, voire vulgaire, aux yeux de l’aristocratie, quand la petite bourgeoisie se met à le porter.
Les couleurs sont donc bien autre chose que des signaux électriques envoyés à notre rétine. Elles ont également une forte portée subjective, difficile à expliquer.
Pour tenter de cerner un peu mieux cette question, nous vous invitons à assister à la conférence de Michel Pastoureau sur son ouvrage Rose, le 15 septembre 2025.
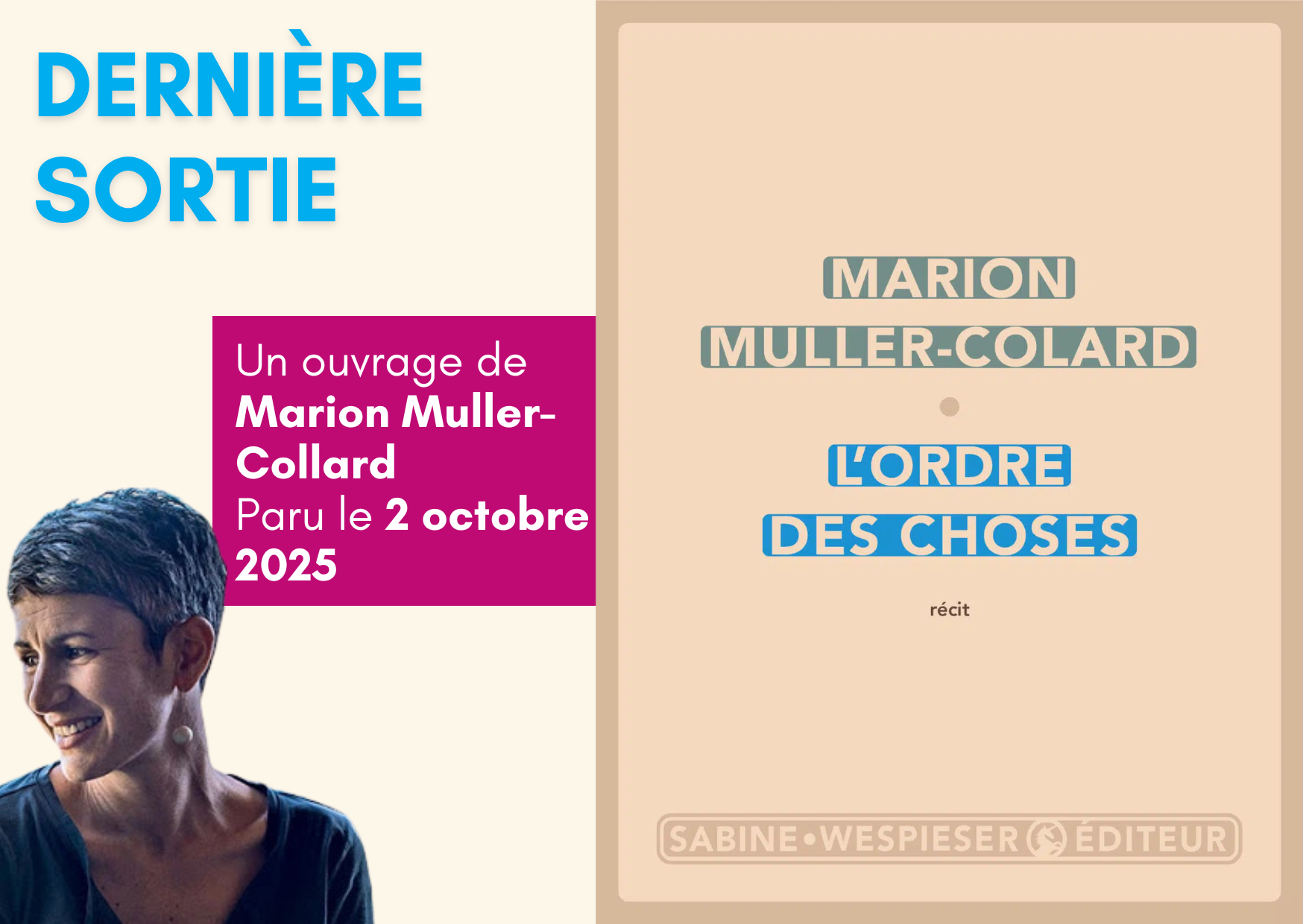
L'ordre des choses, de Marion Muller-Collard

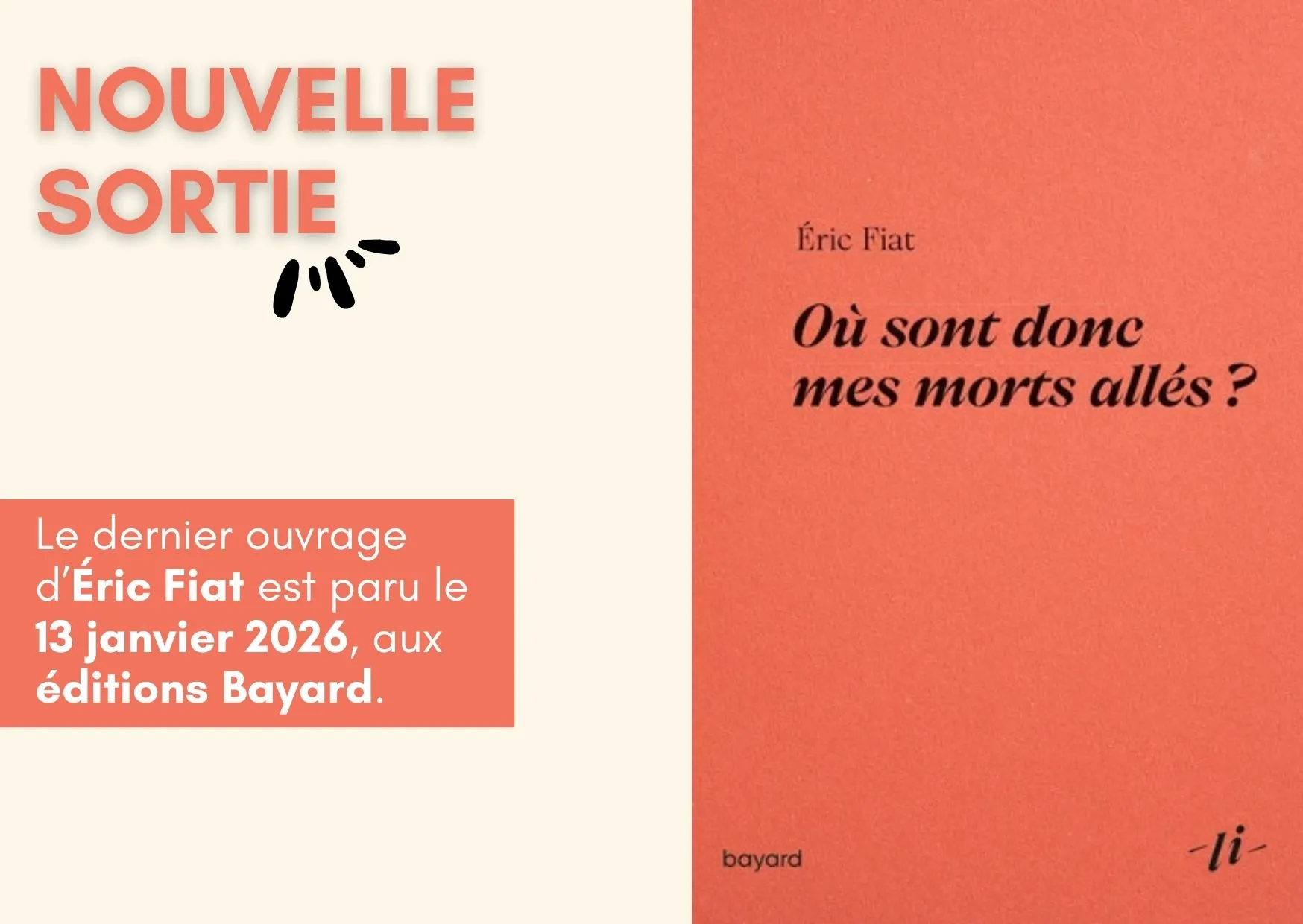

.webp)
.webp)