Pourquoi se raconte-t-on des histoires ?
Nous apprenons l’Histoire sur les bancs de l’école, tous les événements marquants qui s’inscrivent dans un passé commun. Mais l’histoire au sens du récit dépasse le rapport …

Nous apprenons l’Histoire sur les bancs de l’école, tous les événements marquants qui s’inscrivent dans un passé commun. Mais l’histoire au sens du récit dépasse le rapport au passé comme suite d’événements significatifs. Les récits et les histoires ponctuent notre quotidien, des œuvres fictionnelles aux histoires qu’on se raconte les uns aux autres, et également à soi-même.
Si nous pouvons dater la naissance de l’histoire comme science, le fait de « se raconter des histoires », de partager des récits, remonte bien plus loin dans l’histoire de l’humanité : toutes les traditions orales et écrites nous montrent la place centrale des histoires dans toute société. On raconte à son ou sa partenaire sa journée, on écoute les récits de nos parents et de nos familles,on a notre propre manière de percevoir et de définir « notre histoire » personnelle, autrement dit qui nous pensons être par rapport à qui nous avons été, les récits sont au centre de nos existences.
C’est à la méthode psychanalytique que nous devons l’idée fondamentale que parler de nous, c’est dire qui l’on est.
D’un côté, les images qui nous viennent quand on parle de nous sont révélatrices de la manière dont nous nous percevons. Le fait de penser spontanément à certaines choses et non à d’autres – non pas le travail de la mémoire mais la mémoire au travail – est une indication de ce qui est significatif pour nous. L’aspect signifiant, c’est-à-dire l’importance que nous accordons à tel ou tel fait, se montre au moment de raconter, de faire le récit de notre vie.
D’un autre côté, l’acte de parler a une dimension explicative, ici comprise au sens étymologique de déplier, de déployer ce qui était caché ; parler c’est là encore « dire qui l’on est », ou ce que l’on est, et faire le récit de ses exploits ou de ses échecs, de ses amours et de ses déceptions, c’est établir l’historicité d’une identité.
Ainsi, les histoires n’ont pas qu’une portée ludique ou divertissante. Certes, nous consommons des romans de toutes sortes, des films, des séries, des mangas, etc., mais l’acte même de se plonger dans des histoires constitue un phénomène proprement humain et trop universel, trop important, pour être réduit à du divertissement.
Pourquoi se raconte-t-on des histoires ?
On voit, à l’intérêt que nous portons à aux histoires que nous racontent nos proches, que les œuvres d’art n’ont pas le monopole du narratif. Nous connaissons tous et toutes des personnes qui sont de très bonnes narratrices, et qui parviennent à nous captiver par l’inflexion de leur voix, le choix des pauses ainsi que de l’agencement du récit. La narration possède donc certaines lois, certaines structures propres qui nous rendent le récit plus agréable. Est-ce toujours la même logique narrative qui nous fait apprécier la lecture ou le visionnage de telles œuvres plutôt que d’autres ? Au-delà du contenu, la forme même du récit est signifiante : les manières de raconter et de montrer sont constitutives des histoires qu’on se raconte, et sont des indicateurs de ce qu’on recherche dans ces histoires.
Enfin, au-delà du rapport personnel à une œuvre et au-delà des histoires qu’on se raconte entre proches, les grands récits historiques que nous partageons, ou ceux que d’autres tentent de nous imposer, sont encore des phénomènes relatifs à l’acte de se raconter des histoires, et ont une portée politique considérable.
En effet, si les valeurs font le socle d’une société (liberté, égalité, fraternité, pour n’en citer que quelques-unes), elles souffrent du défaut d’abstraction si on ne les inscrit pas dans une histoire commune et dans un vivre-ensemble qui, à son tour, fait l’objet d’un récit, d’une manière de parler de nous et de notre identité commune. Il semble alors que partager des histoires et s’en raconter les uns aux autres tout en conservant la liberté de les critiquer soit une part essentielle de la vie démocratique.
On le voit, il y a d’un côté l’histoire écrite dans les livres, le passé révolu, et d’un autre côté il y a l’histoire vivante, l’histoire en formation, c’est-à-dire en formulation, que l’on nomme le présent. Cette histoire passe par les histoires que nous nous racontons tous les jours, objet de contributions et d’influences toujours nouvelles, d’inflexions et de choix qui décident de ce qui sera par la suite conservé ou oublié.
Dans son cycle de conférences, Michel Eltchaninoff nous introduira à une pensée du récit sous cette forme vivante.
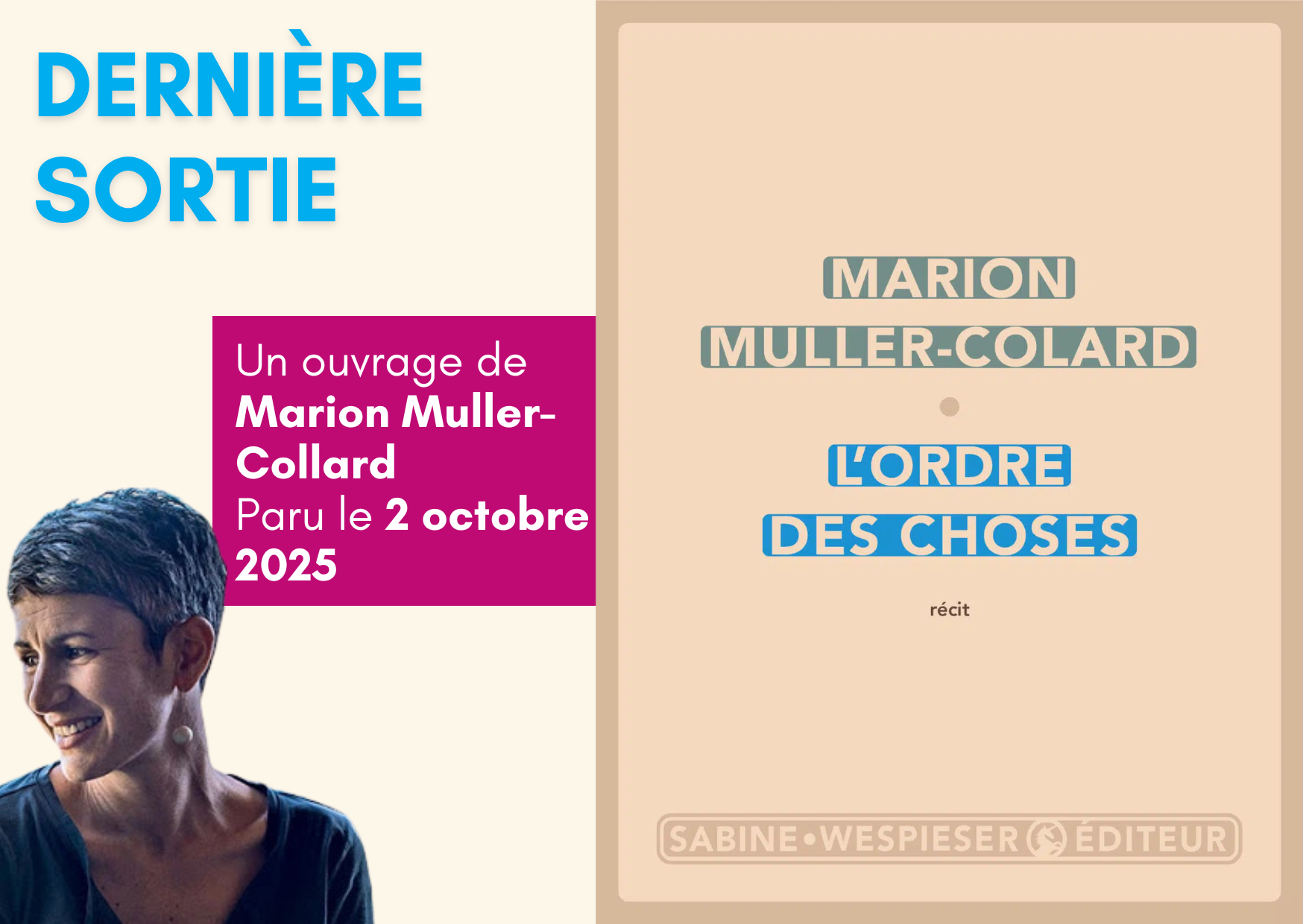
L'ordre des choses, de Marion Muller-Collard

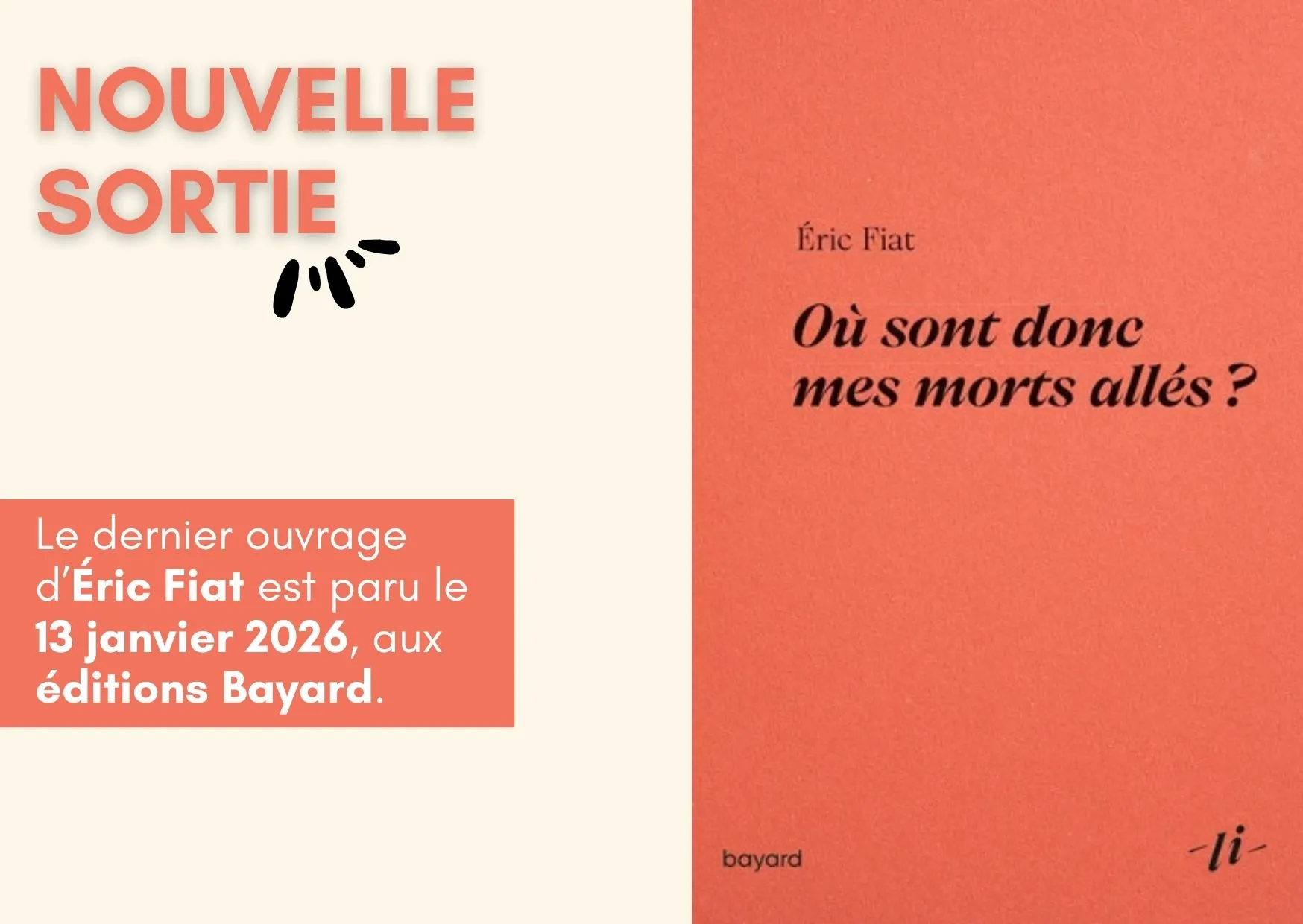

.webp)
.webp)