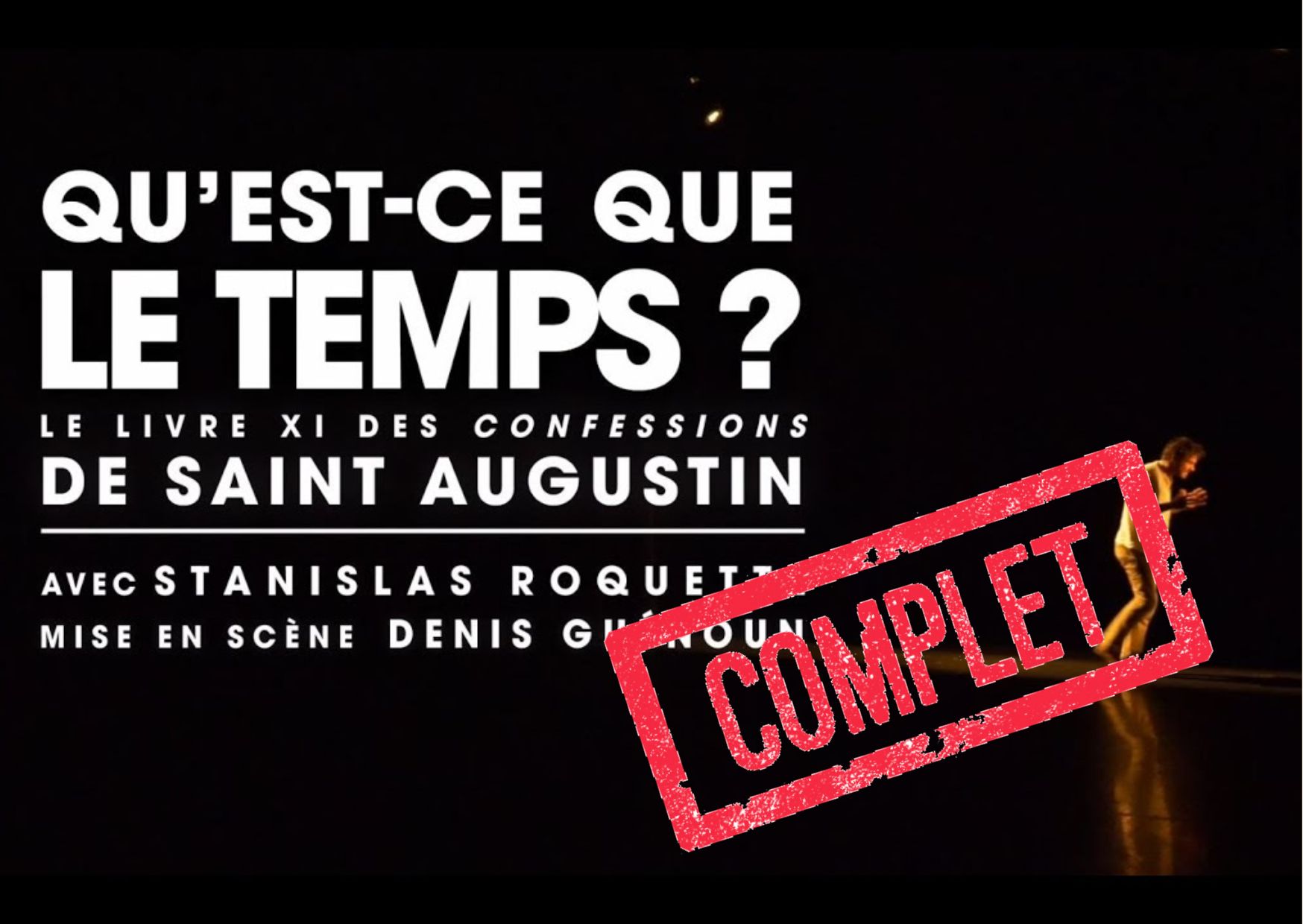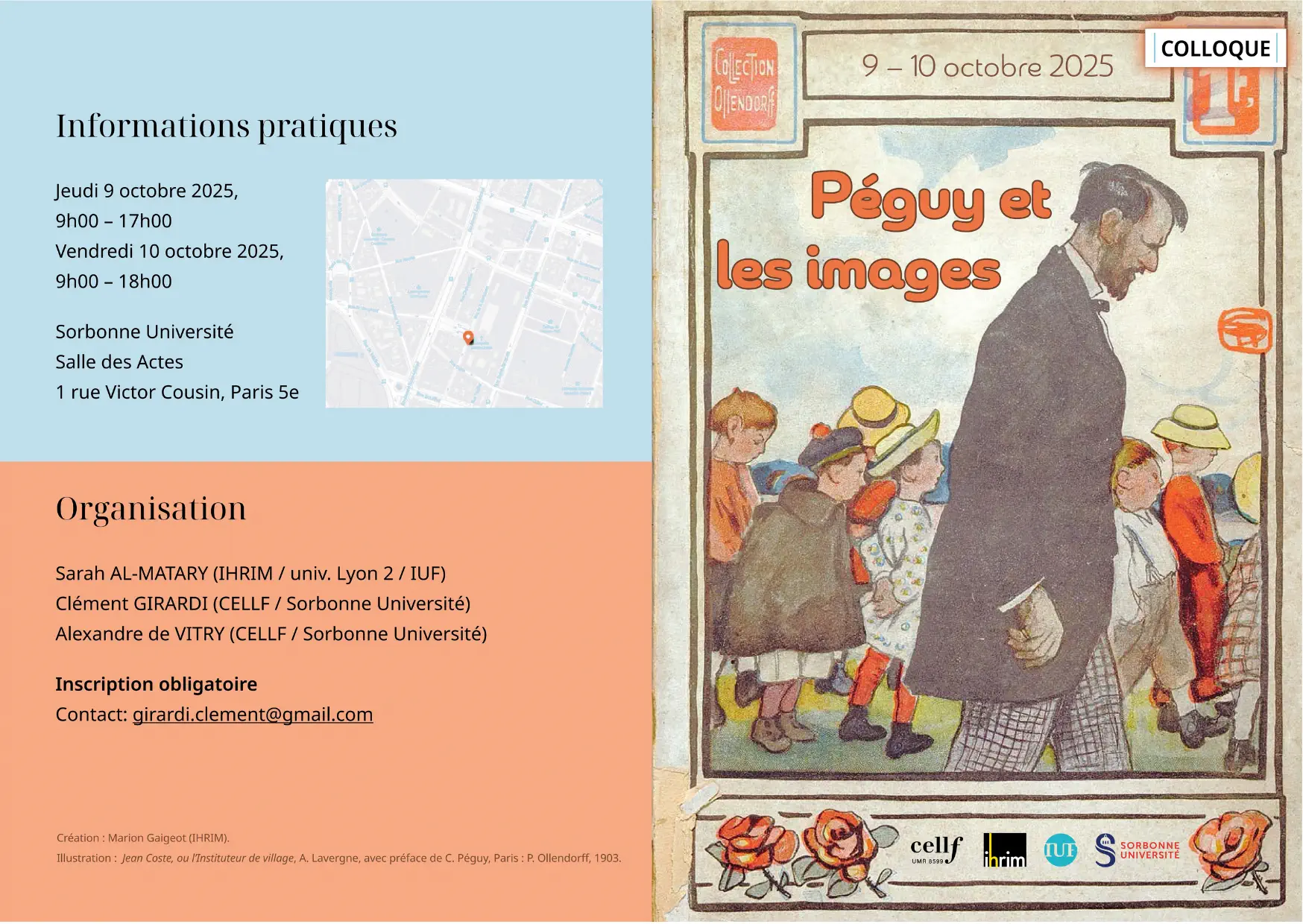Racines et sémantique linguistique à propos de la croyance et de la foi en islam
Un article de Kahina Bahloul, pour compléter sa conférence du 4 novembre

Racines et sémantique linguistique à propos de la croyance et de la foi en islam
1. ʾĀ–M–N (āmana) : la confiance et la sécurité
C’est la racine fondamentale de la foi en islam.
Elle donne naissance à al-īmān (الإيمان), la foi ;
à al-muʾmin (المؤمن), le croyant ;
et à al-amn (الأمن), la paix, la sûreté.
Le lien est transparent : croire, c’est se mettre en sûreté en Dieu.
C’est confier son être à ce qui ne trompe pas.
Ainsi, le Coran présente la foi comme une expérience de confiance avant d’être une adhésion doctrinale.
Lorsque Dieu s’adresse aux croyants, Il dit :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » – “Ô vous qui avez cru !”
et non : “Ô vous qui avez pensé”, ou “qui avez compris”.
La foi, al-īmān, est un acte du cœur : tasdīq bi-l-qalb, la ratification intime du vrai.
De cette racine dérive également le nom divin al-Muʾmin — Celui qui accorde la sécurité, la paix.
Ainsi, le croyant (al-muʾmin) est celui qui reçoit en lui une part de la paix divine, et qui devient lui-même source de paix pour autrui.
Croire, c’est participer à cette circulation de sûreté intérieure.
Croire, c’est pacifier.
2. Ṣ–D–Q (ṣadaqa) : la véracité et l’accord
Cette racine signifie dire vrai, être véridique.
D’où viennent ṣidq (véracité), ṣadīq (ami sincère), taṣdīq (ratification).
Croire, en ce sens, ce n’est pas seulement se fier à Dieu — c’est le confirmer dans sa parole.
C’est donner crédit à la vérité révélée.
Le Coran dit à propos des prophètes :
« وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ »
“Celui qui est venu avec la vérité et celui qui l’a confirmée, ceux-là sont les pieux.” (39:33)
Le croyant est celui qui confirme (yuṣaddiq) :
il devient témoin de la vérité en l’attestant de tout son être.
La foi devient ici un acte de véridicité : être vrai envers Dieu.
Le taṣdīq est l’acte intime par lequel le cœur dit : oui, cela est vrai.
Et c’est cette parole intérieure, silencieuse, qui fonde la certitude.
3. ʿ–Q–D (ʿaqada) : nouer, attacher, relier
La racine ʿaqd signifie littéralement faire un nœud, sceller un lien, contracter un engagement.
D’où viennent les mots ʿaqd (contrat), ʿaqīda (dogme), iʿtiqād (croyance).
Le croyant, dans ce registre, est celui qui attache son cœur à une vérité :
il lie son existence à Dieu comme on lie un pacte.
Le Coran parle d’ailleurs du ʿahd, le “pacte primordial” :
« أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » – “Ne suis-Je pas votre Seigneur ?”
et ils dirent : « بَلَى » – “Oui, nous en témoignons.” (7:172)
L’iʿtiqād est donc la mémoire de ce pacte intérieur, ce nœud originel par lequel l’âme s’est reconnue liée à son Créateur.
Mais ce nœud, lorsqu’il devient rigide, se transforme en dogme exclusif ; lorsqu’il demeure vivant, il reste corde de lumière.
Ainsi, Ibn ʿArabī dira plus tard que tout iʿtiqād est une forme de Dieu, une empreinte du Réel dans la conscience.
Mais cette forme doit rester fluide, car le Réel est infini.
4. Ẓ–N–N (ẓanna) : l’opinion, l’attente, le soupçon
Enfin, la racine ẓ-n-n introduit la nuance du penser que, du supposer.
C’est le champ du ẓann : la conjecture, l’opinion, mais aussi l’attente confiante.
Le Coran emploie souvent ce terme de manière critique :
« وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا »
“La conjecture ne tient en rien lieu de vérité.” (10:36)
Mais par ailleurs, la tradition propétique valorise la bonne opinion de Dieu :
« أنا عند ظن عبدي بي » – “Je suis selon l’opinion que Mon serviteur a de Moi.”
Le ẓann, dans la perspective spirituelle, devient le lieu de la transformation du croire :
tant qu’il reste soupçon, il éloigne ;
lorsqu’il devient espérance, il attire.
Le bon ẓann est la porte de la foi.
.png)